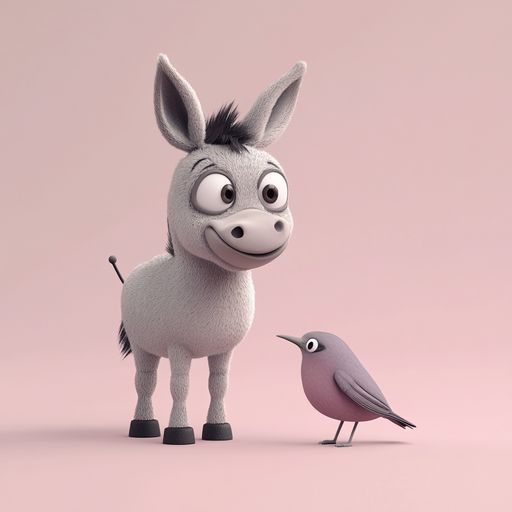L'Âne et le Cochon Théodore Lorin (19è siècle)
« A quelle affreuse destinée
Ma vie est-elle condamnée !
Disait Aliboron. Dès le plus grand matin,
En m'accablant de coups on me mène au moulin :
Point de repos de toute la semaine.
De plus, on me nourrit à peine.
Quelques chardons que j'attrape en passant,
Un peu de foin qu'en rechignant
On me jette parfois, et quelques brins de paille,
Voilà la triste victuaille
Que je reçois après un travail assidu ;
Tandis que ce pourceau, dans sa bauge étendu,
Dort, sans se déranger, la grasse matinée,
Mange et boit toute la journée ;
Chaque matin et chaque soir,
D'une abondante nourriture
Des valets empressés ont soin de le pourvoir.
Qu'a-t-il donc fait à la Nature ?
Puis ajoutez qu'il n'est ni beau, ni gracieux :
Bien loin de là. Sur mon honneur, les dieux
En réglant nos destins avaient perdu la tête. »
Ce propos sacrilège autant que malhonnête
Aurait bien mérité quelques coups de bâton ;
Mais Jupin est puissant, et partant il est bon ;
Son inépuisable clémence
Pardonne aux malheureux un peu d'impatience.
Au reste laissons là tous ces oiseux discours
Et revenons. Au bout de quelques jours
De la blonde Cérès on célébra la fête.
Le maître des deux animaux
Comptait parmi les plus fervents dévots :
De son cochon il dévoua la tête.
De fleurs et de festons dom Pourceau couronné
Pompeusement à l'autel est traîné :
Aussitôt arrivé, deux prêtres implacables
L'égorgent sans pitié. Le pauvre Aliboron,
Qui passait par hasard, du malheureux cochon
Entend les cris épouvantables.
« Ah ! dit-il à part lui, contre toute raison,
Du destin envers moi j'accusais l'injustice ;
Car, après tout, pour prix de mon rude service,
Tant bien que mal mon maître a soin de me nourrir,
Sans vouloir, que je crois, m'offrir en sacrifice.
Ma foi ! mieux vaut encor travailler que mourir. »